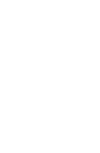Alexandre Rambaud est Maître de Conférence et co-responsable de la chaire “comptabilité écologique” à Agro-Paris Tech, et chercheur au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (CIRED). Il interviendra le 13 avril de 12h à 13h dans le cadre de notre défi Biodiversité pour une Conférence Action sur la thématique “Biodiversité et comptabilité : un langage commun ?”
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis maître de Conférences à AgroParis Tech, chercheur au Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED) et chercheur associé à l’université Paris-Dauphine, co-directeur de la chaire Comptabilité Écologique et du département « Économie et Société » du Collège des Bernardins. Je viens également d’être nommé Fellow à l’institut des Bacheliers et je suis membre de la commission Climat et Finance Durable de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)..
Pour commencer, qu’est-ce qui vous a amené à porter la vision d’une révolution comptable ?
J’ai commencé comme chercheur en mathématiques, avant de m’orienter en économie de l’environnement. J’ai ensuite été séduit par les travaux de Jacques Richard et j’ai réalisé une thèse sur la comptabilité socio-environnementale. C’est lui qui a réussi à me montrer que la comptabilité n’était pas juste un outil technique, qu’elle cachait une vraie compréhension sociologique et politique du monde et que c’était un moyen d’action extraordinaire. Lorsqu’il a commencé à travailler sur le modèle CARE, cela m’a passionné et j’ai apporté ma touche de mathématicien.
“ La comptabilité n’est pas juste un outil technique, elle cache une vraie compréhension sociologique et politique du monde et c’est un moyen d’action extraordinaire. ”
Justement, quel est votre rôle dans la création de la méthode CARE (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology) ?
J’ai apporté un esprit de modélisation et de connexion vraiment forte avec l’économie. Le but de ce modèle n’est pas juste de développer une énième méthode de reporting, mais d’avoir une réflexion de fond sur la connexion entre les normes comptables et l’économie, ainsi que sur les conséquences de la mise en place d’un tel modèle sur l’écologie.
J’ai donc aidé Jacques Richard sur la théorisation et la structuration de CARE, et j’ai pris le relai sur le développement opérationnel du modèle.
Comment définiriez-vous ce modèle CARE ? En quoi est-il adapté aux enjeux écologiques actuels et à venir ?
Le modèle CARE provient d’une analyse critique de la comptabilité financière et des connaissances actuelles des sciences écologiques.
Actuellement, les modèles de comptabilité tendent majoritairement vers des orientations néoclassiques. Ils ne considèrent le capital humain et naturel que lorsque la nature et l’homme sont intrinsèquement productifs. De plus, le marché est considéré comme omniscient, ce qui revient à réduire tout problème à la recherche d’une valeur de marché, y compris pour ce qu’on appelle les externalités (sociales et environnementales). La comptabilité est donc utilisée uniquement pour permettre aux actionnaires de valoriser leur valeur actionnariale, notamment en intériorisant ces externalités pour corriger les différences de marché.
Ces pratiques nous mènent à gérer les problèmes environnementaux, comme le dérèglement climatique, avec des analyses coût/bénéfices (ou risques/opportunités) qui ne sont pas compatibles avec le niveau d’exigence scientifique et écologique de préservation de l’environnement. C’est notamment le cas des approches qui considèrent la nature comme une fournisseuse de services écosystémiques. Depuis les années 70, de nombreux travaux scientifiques ont démontré que la maximisation de ces analyses coût/bénéfices peuvent conduire à l’extermination de populations naturelles et ne s’alignent jamais avec le niveau de résilience des écosystèmes.
“ Actuellement, les modèles de comptabilité tendent majoritairement vers des orientations néoclassiques. Ils ne considèrent le capital humain et naturel que lorsque la nature et l’homme sont intrinsèquement productifs. ”
C’est donc ici que se révèle la spécificité de l’approche CARE ?
Tout à fait, en opposition à ces approches néo-classiques, le modèle CARE propose de définir la durabilité comme la préservation de ce à quoi l’on tient. C’est collectivement et en faisant appel à la science que l’on détermine les entités capitales qu’il faut préserver, comme le climat, et par quelles activités on y arrive. Pour cela, il faut que l’économie et la comptabilité internalisent et pilotent au mieux les coûts nécessaires pour permettre la préservation de ces entités.
Pour prendre l’exemple du dérèglement climatique, lorsqu’une entreprise émet des gaz à effet de serre, elle emprunte le climat et doit donc le rembourser en l’état. Pour gérer son endettement, elle doit réduire son impact sur le climat et mettre en place des activités de préservation qui visent à contribuer à la stabilité climatique. Cela implique une compréhension de la structuration des coûts de préservation et d’évitement, et de ce qu’est la stabilité climatique.
Le modèle CARE structure donc en interne des dettes vis-à-vis d’entités capitales, comme le climat, et des coûts liés à ces dettes. Cela permet aux décideurs d’avoir une relecture de leur modèle d’affaire et d’obtenir des informations structurelles qui peuvent les aider à assurer la préservation de tous les capitaux.
“ Le modèle CARE propose de définir la durabilité comme la préservation de ce à quoi l’on tient. C’est collectivement et en faisant appel à la science que l’on détermine les entités capitales qu’il faut préserver, comme le climat, et par quelles activités on y arrive. ”
N’y a-t-il pas un risque de recourir systématiquement à la compensation pour recouvrir ses dettes extra-financières ?
Tout dépend de ce que l’on entend par compensation. Pour reprendre l’exemple du climat, tout doit être analysé sous l’angle suivant : est-ce que l’action que l’on mène garantit la préservation climatique ? Si l’on s’intéresse aux puits de carbone, il faut qu’ils reposent sur une base scientifique, avec une sécurisation du stockage. Pour donner un ordre d’idée, les coûts attenant pour stocker une tonne de carbone avec garantie et sécurisation de stockage s’élèvent à environ mille euros la tonne.
Vous prônez un alignement du capital financier avec le capital humain et le capital naturel, pouvez-vous nous en dire plus ?
Lorsque des acteurs (actionnaires, propriétaires, fournisseurs) apportent du capital à une entreprise, ils font une avance en argent : c’est ce que l’on appelle le capital financier. Tous les apporteurs sont traités au même niveau et la comptabilité sert à savoir ce qui a été fait avec cet argent. Ce que le modèle CARE dit, c’est qu’il faut conserver ce mécanisme et l’étendre aux autres avances (en climat, en sols, en écosystèmes) afin qu’elles soient remboursées en état et sans hiérarchie. Il s’agit donc d’une continuité du système comptable qui existe déjà dans de nombreuses entreprises.
Si l’on prend l’exemple du capital humain, qu’est-ce que cela implique concrètement ?
Dans le modèle CARE, chaque être humain qui travaille pour une entreprise est une entité capitale. Le salaire n’existe pas comme tel car il est déconstruit. Une partie sert à garantir la préservation de l’être humain et correspond à ce qu’on appelle le salaire décent. Le reste représente des charges liées à l’obtention de certaines compétences ou à un coût d’accès à la personne, qui ne sont plus liées aux enjeux de préservation du capital humain.
Une entreprise doit donc verser un salaire au moins supérieur au salaire décent pour préserver ses capitaux humains et ne pas s’endetter auprès de ces entités. Cette approche permet également de comprendre comment est alloué l’argent dans la gestion des capitaux humains, entre salaire décent et autres charges.
Dans le cas d’un chef d’entreprise qui s’intéresse au modèle CARE, quelle démarche doit-il suivre pour le mettre en place ? Quels vont être les changements dans le fonctionnement de son entreprise ?
Il y a déjà de nombreuses entreprises qui mettent en place ce modèle, des TPE jusqu’aux grandes multinationales. Cela peut se structurer soit sous la forme de programmes de recherches (il faut passer par la chaire Comptabilité écologique), soit sous la forme de développement R&D (il faut passer par des cabinets spécialisés comme ComptaDurable).
Nous allons lancer en avril une association qui permettra de fédérer les professionnels (institutionnels et ONG) qui sont intéressés par le modèle. Elle contiendra le centre méthodologique de CARE et servira également de guichet d’accueil pour les entreprises qui souhaitent mettre en place le modèle, afin de leur orienter au mieux vers les bons acteurs. L’idée est de fonctionner en écosystème et en projets collaboratifs.
Nous travaillons beaucoup sur les imaginaires et l’écriture de nouveaux récits chez ENGAGE. À quoi ressemblent vos futurs désirables ?
Si déjà il y avait la possibilité de reconnaître les dettes vis-à-vis des êtres humains et de la nature, ce serait énorme. Ce serait une clé importante pour résoudre les enjeux de durabilité.