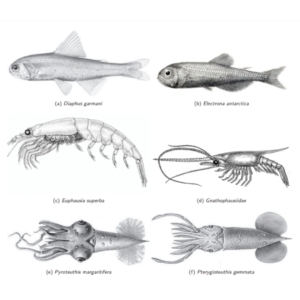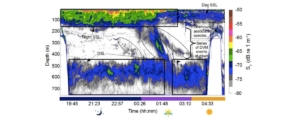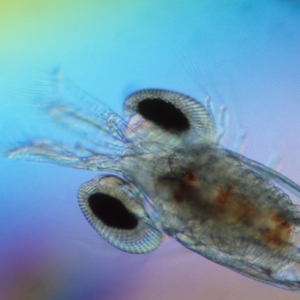François Gemenne travaille sur la gouvernance de deux des enjeux globaux du 21ème siècle : le climat et les migrations. Il s’intéresse en particulier aux dimensions géopolitiques du changement climatique, à la fois dans ses impacts et sa régulation. Il est professeur à HEC Paris et directeur de The Hugo Observatory. Il est notamment l’auteur de l’Atlas de l’Anthropocène.
ENGAGE : Que retires-tu de la COP 30 à Belém ?
François Gemenne : Je dirais que, malgré les difficultés logistiques d’accès, c’est réjouissant qu’on continue à attirer des gens du monde entier, d’horizons très divers – politiques, économiques, militants, médiatiques – autour d’un seul but.
Il y a, malgré les critiques, quelque chose de très joyeux, de très enthousiasmant à voir toutes ces personnes, toutes ces organisations, converger en un endroit, autour d’une sorte d’idée, d’ambition commune.
Bien sûr, ils ne sont pas représentatifs de la population mondiale, mais c’est tout de même l’un des événements où chacun essaie de concourir à un but commun.
Le problème, c’est que l’enthousiasme des participants est chaque année un peu plus émoussé par la déception du texte final. Le résultat politique n’est pas à la hauteur de la mobilisation et de l’enthousiasme que provoque l’événement.
ENGAGE : Avec quel sentiment ressors-tu ?
François Gemenne : La question centrale est : que faudrait-il faire pour que ces réunions donnent des résultats plus tangibles et ne soient pas des machines à décevoir le public et à envoyer des signaux contradictoires aux acteurs économiques ?
De manière un peu provocative, on a presque envie de dire qu’il faudrait tout garder sauf les gouvernements. Mais c’est justement l’absence d’action des gouvernements qui est centrale et qui justifie tout le reste.
Il faudrait aussi davantage clarifier le rôle des entreprises dans la COP. Il y a une ambiguïté : elles sont à la fois bienvenues et suspectes.
On se réjouit qu’il y ait de plus en plus de monde, que le monde économique soit de plus en plus présent et engagé… mais on les accuse de faire du lobbying.
Les entreprises s’intéressent de plus en plus aux COP, au climat en général, donc elles envoient des représentants pour voir ce qui s’y passe, signer des contrats, trouver des financements.
D’une certaine façon, La COP est devenue une sorte de grande marketplace des énergies renouvelables. Un peu comme le festival de Cannes ou de l’aviation au Bourget.
ENGAGE : D’accord, mais Cannes n’est pas un événement politique…
François Gemenne : Exactement. La COP est devenue, aussi, une sorte de grand marché. Une sorte de “Change Now” à l’échelle mondiale. Cette dimension s’est fortement renforcée ces dix dernières années, depuis la COP21.
ENGAGE : En exagérant un peu le trait, tu penses donc, tu dis finalement que c’est devenu une conférence de plus ?
François Gemenne : Oui. Et du coup, son ambition de régulateur climatique mondial disparaît peu à peu.
Le processus politique donne l’impression d’arriver au bout de ce qu’il peut donner.
L’accord de Paris reste un horizon assez indépassable. Pour aller plus loin, il faudrait des engagements contraignants — mais personne n’en veut aujourd’hui.
C’est devenu un truc très hybride. Une sorte de Davos du climat.
Même décalage que Davos, si tu veux, beaucoup d’acteurs, beaucoup de rencontres, mais politiquement ça reste bloqué.
ENGAGE : Comment dépasser ça ?
François Gemenne : Je vois trois pistes.
Première piste, arrêter de tout focaliser sur la décision finale, impossible à obtenir à 195 car d’autres programmes avancent en parallèle, mais personne ne les regarde.
Deuxième piste, casser la règle du consensus. Permettre à des coalitions de pays d’avancer sur certains sujets. C’est ce que fait la Colombie avec le sommet de Santa Marta sur la sortie des fossiles : rassembler 40 ou 50 pays volontaires. On aura de vrais engagements, en passant du multilatéralisme au minilatéralisme.
Et je plaiderais pour que ces initiatives se fassent dans la COP, pas en dehors, pour ne pas l’affaiblir.
Troisième piste, assumer la fonction marketplace. Permettre aux entreprises, villes, collectivités, de participer réellement à certaines réunions pour sortir de l’ambiguïté.
ENGAGE : Mais la COP, au départ, est un processus politique…
François Gemenne : Oui, je te l’accorde. Mais peut-être faut-il accepter qu’il le soit de moins en moins.
Dans le contexte politique actuel, de fait, je fais aujourd’hui plus confiance à beaucoup de patrons du CAC40 qu’à des dirigeants comme Orban ou Milei pour faire avancer la transition. C’est terrible à dire, mais c’est vrai. C’est une leçon assez tragique pour un social démocrate, mais c’est une réalité.
ENGAGE : Mais il faut quand même un cadre réglementaire.
François Gemenne : Oui, sans doute. J’aimerais croire à la réglementation. Mais attendre la réglementation, c’est comme attendre Godot. Il faut être pragmatique car nous devons avancer.
Aujourd’hui, même dans un contexte très peu porteur, la transition continue malgré la politique, notamment dans les énergies.
Les choses avanceront si les entreprises y trouvent un intérêt économique, si la convergence entre intérêts particuliers ou privés et intérêt général se renforce.
ENGAGE : Un message d’espoir à partager ?
François Gemenne : Le fait que cela continue à attirer beaucoup de monde. La diversité des participants. La rencontre entre des personnes et organisations qui, sinon, ne se rencontreraient jamais.
Aujourd’hui, il faut probablement accepter l’idée qu’une erreur de l’Accord de Paris a été de penser que l’impulsion viendrait des gouvernements. En réalité, elle vient surtout de la société.
Pour aller plus loin :
– Commander son livre : L’Atlas de l’Anthropocène