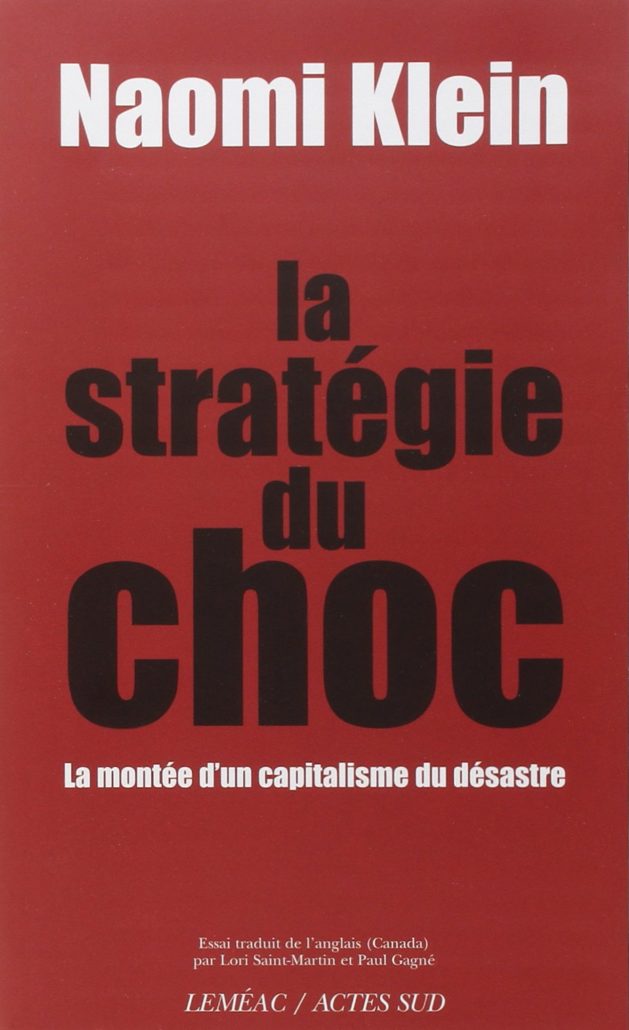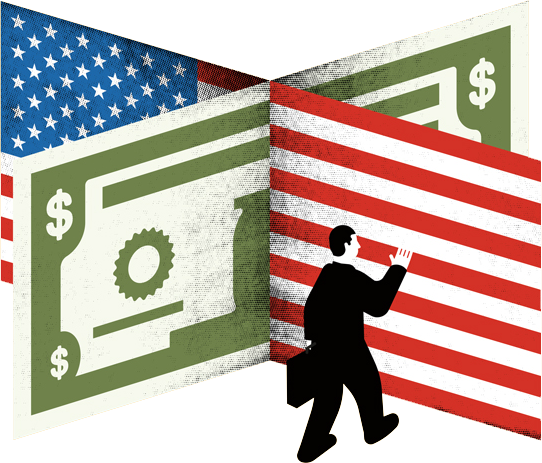Loïc Blondiaux est professeur de sciences politiques, et travaille depuis quinze ans sur les sujets de démocratie participative. Il est aussi membre du comité de gouvernance de la Convention Citoyenne pour le Climat.
Peux-tu nous rappeler comment est née la Convention Citoyenne pour le Climat ?
La Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) a une histoire plurielle et complexe.
Sur le temps long, elle s’inscrit dans la suite d’un certain nombre d’expériences démocratiques ayant eu lieu au Canada, en Irlande, en Islande, et qui ont permis d’envisager la possibilité que des assemblées citoyennes tirées au sort puissent participer au processus constitutionnel ou législatif.
Sur le temps court, la CCC s’ancre dans le contexte de la crise des Gilets Jaunes et dans leur demande de plus de démocratie et de participation citoyenne. L’idée concrète de cette CCC est née d’un texte porté début 2019 par un collectif de citoyens et chercheurs intéressés par l’innovation démocratique, les Gilets Citoyens.
Mais dès 2017, avec la Fondation Nicolas Hulot, nous avions proposé une Assemblée Citoyenne du futur, une réforme constitutionnelle visant à doter la cinquième République d’une troisième assemblée composée en partie de citoyens tirés au sort, qui aurait eu pour vocation de porter les intérêts de long terme dans le processus législatif.
Enfin, la CCC s’inscrit aussi dans le cadre d’un projet de réforme constitutionnelle, aujourd’hui interrompu, pour transformer le Conseil Économique, Social et Environnemental en Chambre de la Participation Citoyenne.
Finalement, la Convention Citoyenne pour le Climat est le creuset de toutes ces idées, initiatives et influences variées.
“ Ce dont souffre la démocratie participative, c’est d’en être toujours restée à l’état d’expérimentation. ”
Après six mois d’expérimentation de la CCC, quelles sont tes premières conclusions ?
A propos de la Convention, nous pourrions reprendre l’expression consacrée de Mark Twain “Nous ne savions pas que c’était impossible, alors nous l’avons fait”. Au sens où il était clairement déraisonnable de penser qu’un groupe de citoyens tirés au sort pourraient produire, en quelques mois, et sous la forme d’articles de lois, des propositions visant à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Cette mission quasiment impossible est pourtant en passe de réussir.
Évidemment, la crise du Coronavirus a affecté tout le processus et nous empêche de nous projeter dans les résultats de la convention. A l’heure actuelle, ce que nous avons observé, c’est qu’un collectif de 150 citoyens tirés au sort, avec une visée effective de diversité sociologique, est parfaitement capable de s’engager dans un processus exigeant, de s’approprier des enjeux habituellement considérés comme trop complexes pour être confiés à des non experts, et de formuler des propositions pertinentes et pour certaines radicales, afin de faire advenir la transition écologique.
Évidemment, ces propositions avaient déjà été réfléchies par des experts et des acteurs de la société civile, mais les citoyens ont su les sélectionner en fondant leurs arbitrages sur deux principaux critères : leurs effets sur les émissions de gaz à effet de serre et l’impératif de justice sociale.
Qu’est-ce que le Coronavirus change dans le processus de la CCC ?
Le confinement interdit la réunion physique qui est une condition de l’efficacité du travail des citoyens et de la légitimité de leurs travaux. Le processus est donc pour l’instant en suspens.
Un autre problème est la complexité forte à intégrer les informations nouvelles liées à la crise du coronavirus dans les travaux effectués depuis six mois, alors même que les citoyens n’ont plus la possibilité de se réunir physiquement pour débattre.
Malgré les difficultés du présent, je veux insister sur l’incroyable niveau d’engagement et d’implication de ces 150 citoyens. Même en confinement, ils continent à réfléchir, à s’informer, à avancer sur des thèmes transversaux. Nous sommes tous impressionnés par la qualité des délibérations citoyennes.
Les travaux continuent d’ailleurs en ce moment. Jeudi et vendredi derniers les citoyens étaient prêts de 130, connectés en ligne via zoom, à réfléchir ensemble à la rédaction d’une message commun destiné à la population et à l’exécutif. Nous expérimentons la possibilité d’une délibération en ligne et celle-ci semble désormais possible techniquement, sans conséquence majeure sur la qualité du travail démocratique, ce qui est une bonne nouvelle.
“ Il ne faut pas croire que « l’après » viendra après. L’après c’est maintenant. ”
Penses-tu qu’il y aura un avant et un après la CCC ?
Oui, dans l’hypothèse où les propositions citoyennes peuvent dans le processus législatif ou dans l’organisation d’un référendum obligatoire.
Jusqu’à aujourd’hui, l’exécutif a plutôt évoqué un référendum consultatif, ce qui me paraît très insuffisant. Ce dont souffre la démocratie participative, c’est justement d’en être toujours restée à l’état d’expérimentation. Elle a aujourd’hui besoin d’institutionnalisation pour que, demain, la délibération des citoyens tirés au sort soit un critère clé de légitimation des décisions politiques.
Avec l’arrivée du Coronavirus, l’incertitude sur l’état futur des économies et des sociétés ne nous permet pas de savoir ce que sera la place des impératif écologique et démocratique dans les mois à venir. L’écologie et la démocratie risquent d’être les grandes perdantes de la période en cours, si nous ne nous mobilisons pas pour les défendre. Nous sommes dans un moment de grande incertitude où tout se joue.
Attention, il ne faut pas croire que « l’après » viendra après. L’après c’est maintenant. A travers nos réflexions, nos propositions, notre capacité à ne pas succomber à la tentation du retour en arrière, ni aux sirènes de l’autoritarisme. Nous sommes déjà collectivement en train de fabriquer l’après.
“ Prendre soin des autres et du reste des vivants, consommer moins et mieux, ralentir volontairement après y avoir été contraints : autant de changements dans nos formes de vie que nous expérimentons par la force aujourd’hui et que nous pouvons projeter dans l’avenir. ”
Tu parles du référendum comme un moyen efficace pour arbitrer sur les propositions de la CCC. Ne penses-tu pas que ce mode de décision sondagier risque de nier la démocratie ?
Tout dépend du point de vue que l’on porte sur le référendum. Certains y voient un déni de démocratie, du fait de leur caractère plébiscitaire. Je suis personnellement de l’avis de Cristina Lafont qui explique dans Democracy Without Shortcuts que l’idéal démocratique exige que le plus grand nombre puisse participer au processus de décision collective. Il me semble que le référendum est un instrument démocratique par excellence lorsqu’il est précédé d’une vraie délibération collective, et lorsque le vote n’est pas présenté sous une forme binaire (oui ou non) mais sous une forme plus complexe, à l’image du référendum sur le traité constitutionnel européen.
Que pouvons-nous faire à l’échelle individuelle et collective pour que la crise en cours ne nous mène pas à un retour au « monde d’avant » ?
A l’échelle individuelle, pour les personnes confinées, ce temps doit aider à prendre du recul par rapport à ses propres croyances et à son mode de vie. En quelque sorte, retrouver l’otium des latins, ce temps libre voué au repos, à la méditation et aux loisirs studieux, un temps hors du monde indissociable de la « vie bonne ». Il me semble de ce point de vue que, même si nous ne sommes pas en première ligne dans la lutte contre le coronavirus comme le sont tous ceux qui dans les hôpitaux, les ehpad, les chaînes de production et de distribution de biens essentiels et les services publics sont en train d’assurer notre survie, nous autres confinés pouvons contribuer à ne pas reproduire les comportements qui nous ont amené là où nous en sommes. Prendre soin des autres et du reste des vivants, consommer moins et mieux, ralentir volontairement après y avoir été contraints : autant de changements dans nos formes de vie que nous expérimentons par la force aujourd’hui et que nous pouvons projeter dans l’avenir.
D’un point de vue collectif, il faut que les adversaires du retour à « l’avant » se rassemblent, s’organisent et développent des imaginaires capables d’affronter, sinon d’empêcher empêcher les effondrements à venir. Alors même que nous ne pouvons pas nous rencontrer ou nous réunir physiquement, c’est aujourd’hui plus que jamais que nous devons faire de la politique. La politique est notre seule voie de sortie pour sauver le monde. Et j’emploie le mot politique au sens large : s’engager dans des structures de solidarités, des associations, des mouvements politiques, mais aussi produire des idées politiques, élaborer des programmes, concevoir des stratégies d’influence ou de prise de pouvoir.
“ Nous, humains, sommes reliés à des collectifs sociaux et à des environnements naturels sans lesquelles nous ne pourrions pas survivre. ”
Avons-nous besoin de radicalité ?
Oui, nous devons redevenir radicaux. A la fois radicaux dans le sens de la lutte contre nos adversaires qui sont bien réels et particulièrement dangereux. Et radicaux dans le sens d’un retour à nos racines, non pas sur le mode du terroir ou de la nation, mais sur la base de l’axiome selon lequel nous, humains, sommes reliés à des collectifs sociaux et à des environnements naturels sans lesquelles nous ne pourrions pas survivre. L’individu libre et sans attaches, capable de s’émanciper de toute contrainte naturelle et de vivre sans s’associer, est une fiction que l’idéologie néo-libérale a consacré, mais qui reste une fiction. D’ailleurs, la crise sanitaire actuelle nous rappelle que nous devons nos existences individuelles à des systèmes de protection sociale inventés au XIXe siècle et dont la destruction menace chacun d’entre nous.
Nous devons nous concentrer sur ces deux objectifs qui sont, je pense, conciliables : d’une part la protection de nos systèmes de solidarité, structurés à l’échelle nationale, et d’autre part la préservation de nos écosystèmes naturels. Et cela exclut largement l’idée selon laquelle le marché va se substituer à tout le reste…
“ L’essentiel, c’est comment, ici et maintenant, je construis le monde d’après. ”
Si tu devais définir tes futurs désirables, à quoi ressembleraient-ils et comment s’inscriraient-il dans le présent ?
Je ne pense pas que l’on puisse se projeter dans le « monde de l’après » sur un mode purement utopique. Évidemment, il nous faut un imaginaire, mais ça n’est pas l’essentiel. L’essentiel, c’est comment, ici et maintenant, je construis le monde d’après. En essayant de ne pas s’effondrer, en ne renonçant pas, en ne cherchant pas la fuite individuelle, en restant attentif aux autres dans le moment présent, en prêtant attention au monde qui nous entoure, en redécouvrant le sens de notre « résonance » au monde, comme nous le suggère Harmut Rosa.
Dans cette optique, je vais donner un conseil de lecture : Générations Collapsonautes, naviguer par temps d’effondrement de Yves Citton. L’auteur y relie les réflexions des collapsologistes à d’autres clefs de lecture, d’autres références. C’est absolument formidable ! Il nous explique par exemple comment, alors que nous parlons d’un potentiel effondrement futur, une immense majorité de vivants sur Terre, humains et non humains confondus, vivent aujourd’hui cet effondrement au présent et développent des savoir-faire, des savoir-être, des stratégies de résilience dont nous pouvons nous inspirer dès aujourd’hui.