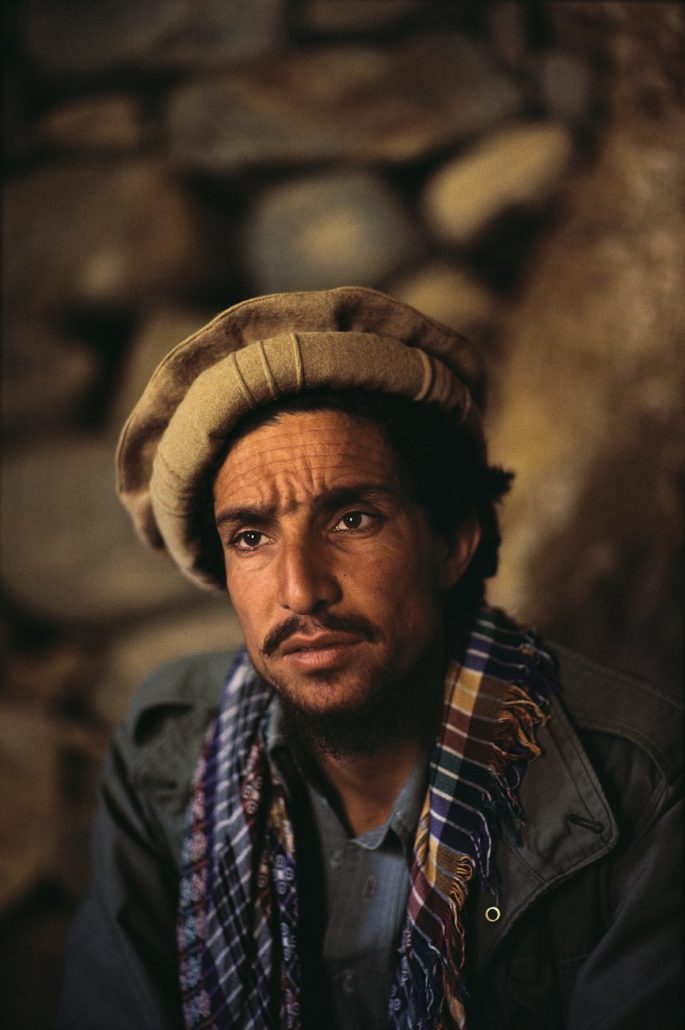Le MOOC “Relever le défi du vivant” sortira le 7 novembre prochain. Les inscriptions sont ouvertes. Rencontre avec Philippe Grandcolas et Véronique Dham, deux de ses intervenants.
Philippe Grandcolas est directeur adjoint scientifique de l’Institut Écologie Environnement, l’un des 10 instituts du CNRS qui regroupe près de 70 laboratoires dans le domaine de l’écologie et de l’environnement.
Véronique Dham est la fondatrice de Biodiv’corp, société de conseil spécialisée en biodiversité.
Pouvez-vous vous présenter ?
PG : Je suis directeur adjoint scientifique de l’Institut Écologie Environnement. Mon domaine de prédilection est l’évolution des insectes, ce qui m’a amené à observer l’environnement dans un certain nombre de pays du sud et à avoir une idée des politiques publiques menées dans ces pays.
J’ai également fondé et développé pendant 10 ans un laboratoire associé au MNHN. Il regroupait 200 scientifiques et travaillait sur des aspects très variés de la biodiversité.
VD : Je suis la fondatrice de Biodiv’corp, société de conseil spécialisée en biodiversité. J’ai créé en 2005 le métier de conseil en biodiversité en France. Aujourd’hui, je suis spécialisée sur le sujet de la biodiversité, quand d’autres acteurs du conseil interviennent sur le carbone, l’économie circulaire, etc…
Comment définiriez-vous la biodiversité ?
PG : C’est la diversité du vivant qui évolue et interagit à toutes les échelles, des molécules dans les organismes aux écosystèmes à l’échelle des continents et des océans.
VD : D’une manière très simple : le monde du vivant, dans toute sa diversité, du plus petit au plus gros. Le plus important reste d’aller au-delà de cette notion de faune et de flore, et d’analyser l’ensemble des interactions qui existent entre ces différentes espèces et entre les écosystèmes qui les hébergent.
On a peur de poser cette question, évidemment, mais elle est centrale, où en est la biodiversité aujourd’hui ?
PG : La biodiversité aujourd’hui est sur une très mauvaise trajectoire.
Depuis 300 à 400 ans, la population humaine se répand et intensifie ses modes de production industriels sur presque l’ensemble de la surface du globe. Les populations ont une capacité de conversion des milieux, de pollution, d’extraction et de contribution au changement climatique inégalée. Aujourd’hui, les circuits longs sont la règle, les transports aériens ainsi que la production agricole et industrielle ne cessent d’augmenter et ce sans rapport avec les besoins de l’espèce humaine. Finalement, le monde d’il y a quelques décennies n’existe plus.
La conséquence : la plupart des populations d’organismes sont en déclin. ⅓ à ⅔ de leurs effectifs ont déjà disparu ou sont en voie de disparition et une extinction de ces populations pourrait avoir lieu à la moitié du siècle, dans 20 à 30 ans. Ainsi, alors que la biodiversité nous assure des services quotidiens tels que l’eau, l’air, la nourriture, le climat, la protection contre les maladies, nous faisons face à une perte de services écosystémiques : certains milieux se désertifient, la production agricole plafonne, le nombre de maladies zoonotiques augmente.
Pour résumer, nous sommes dans une situation qui se détériore, du fait de l’influence conjointe du climat et des rétroactions négatives de la perte de la biodiversité sur le changement climatique. Ce n’est pas un tableau positif, mais je pense que nous devons être honnêtes pour nous permettre de changer les choses.
Le constat est édifiant, on parle de 6ème extinction des espèces. Le phénomène est-il en train de s’accélérer ?
PG : Oui tout à fait, et nous voyons seulement la partie émergée de l’iceberg. Aujourd’hui, deux millions d’espèces sont connues par la science et nous savons que cela ne représente qu’à peine le quart de l’ensemble des espèces. Toutes les projections statistiques confirment que les espèces inconnues sont en train de disparaître au même rythme que celles que nous connaissons.
Les causes varient évidemment en fonction des endroits : si l’on est en plein cœur d’une forêt tropicale, la problématique sera la réduction de la surface de cette forêt. Dans une zone agricole en Europe, les disparitions sont liées à l’épandage de pesticides. Si l’on est dans une zone subtropicale, ce seront les aléas climatiques ou l’altération des sols qui auront les plus gros effets. Dans tous les cas, le bilan global reste très négatif.
Pourtant, les écosystèmes peuvent se régénérer, n’est-ce pas ? Il n’est donc jamais trop tard pour agir ?
PG : Il n’est jamais trop tard certes, mais il faudra arriver à changer nos états d’esprit. Bien sûr, si nous regardons la situation d’une manière comptable, nous connaissons les mesures à prendre pour stopper le déclin de la biodiversité, voire lui permettre de se régénérer en quelques décennies.
Mais nous sommes tributaires de modes de production agricole et de modes d’élevage qui viennent nourrir certaines de nos habitudes telles que celle de manger de la viande à presque tous les repas. Nous avons également un défaut de perception et de compréhension de ce qu’est la biodiversité. Ces deux réalités combinées nous placent dans une situation où nous connaissons les remèdes, mais n’arrivons pas à les appliquer.
Appliquer une législation ne suffira pas, nous avons également besoin de changements culturels et structurels.
L’entreprise s’est emparée tard de ce sujet, encore plus tardivement que de la question climatique. Pourquoi ?
VD : Beaucoup de raisons peuvent l’expliquer… Premièrement, le climat a pris toute la place dans les débats médiatiques au cours des 15 dernières années, la biodiversité est très longtemps restée reléguée au second plan. Dès lors que le sujet était peu traité dans les médias, il était peu traité dans les entreprises.
Ensuite, quand le sujet du climat proposait des outils concrets aux entreprises, pour calculer leur empreinte carbone par exemple, il n’en existait aucun permettant de mesurer l’empreinte biodiversité. L’entreprise étant un milieu très pragmatique, il est indispensable de pouvoir quantifier, mesurer.
Enfin, le climat a eu une gouvernance mondiale plus organisée. Le GIEC a été mis en place près de 10 ans avant l’IPBES, qui est l’équivalent du GIEC pour la biodiversité. Cela donne une idée du retard qui a été pris sur la prise en compte des sujets de biodiversité.
Où en sont le monde économique et les entreprises aujourd’hui ?
VD : On assiste à un moment de bascule depuis environ deux/trois ans. Je pense que la prise de conscience des entreprises a eu lieu en 2019, lorsque l’IPBES a tenu sa plénière à Paris. C’est à ce moment que les médias ont commencé à relayer le sujet et qu’il est arrivé jusqu’au monde de l’entreprise
À l’époque, les constats faits par la plateforme internationale sont alarmants : les grandes causes de l’érosion de la biodiversité sont dues aux activités humaines, et donc aux activités économiques. Au rythme où vont les choses, la dégradation des écosystèmes constitue une réelle menace sur l’activité des entreprises. Se forment alors un certain nombre de coalitions, à l’initiative de grands groupes. Parmi elles : Act for Nature ou Business for Nature.
Dans le même temps, des réglementations émergent au niveau national et international.
Dernièrement, les médias ont davantage mis en avant les liens existants entre biodiversité et changement climatique. Les entreprises comprennent alors de plus en plus que les deux sujets sont liés et qu’il est contre-productif de les traiter séparément.
Enfin, le secteur de la finance s’empare du sujet, considérant que la chute de la biodiversité représente un véritable risque pour leurs investissements. Les entreprises sont alors encouragées à mener des évaluations pour mesurer leur empreinte biodiversité et à mettre en œuvre des actions concrètes pour réduire leur impact.
Vous avez tous les deux accepté d’intervenir dans notre MOOC “Relever le défi du vivant” et nous vous en remercions. Pourquoi ?
PG : Un effort de transmission des connaissances est à faire pour que les décisions adéquates soient prises. Si nous sommes des millions à nous comporter de manière cohérente avec l’environnement, nous aiderons la situation à aller mieux.
Attention toutefois, ces efforts doivent être globaux, équitables et consentis par l’ensemble de la société. Il n’est pas question de faire porter l’effort uniquement aux citoyens ou aux gouvernants.
Ce qui m’a plu dans l’initiative du MOOC réalisé par ENGAGE, c’est la dynamique et le discours percutant qui ouvrent la voie à de réels résultats. J’ai également apprécié la volonté affichée de transmettre un message scientifique. Car derrière toutes ces problématiques, se posent des questions scientifiques, autant sociologiques et politiques que biologiques et climatologiques.
VD : “Biodiversité” est un terme technique et il peut parfois être délicat de savoir ce qu’il signifie. Il est d’autant plus difficile d’établir des liens avec sa propre activité. Il y a toujours besoin d’expliquer, de sensibiliser et de former avant de commencer à mettre en place n’importe quel plan d’action.
Tous les outils à destination des salariés sont doublement bénéfiques : ils permettent d’agir dans le cadre de l’entreprise mais aussi en tant que citoyen.
L’épisode dans lequel vous intervenez dans le MOOC s’intitule “La biodiversité, c’est nous”. Quel est votre message ?
PG : Le message, c’est d’arrêter de nous positionner au-dessus du reste du vivant, avec cette vision dualiste et naïve selon laquelle il y aurait la nature d’un côté et les humains de l’autre. Cette vision, héritée de cultures occidentales classiques depuis 2 ou 3 siècles, est intenable.
Nous ne sommes rien d’autres qu’une espèce de primates ayant eu un succès évolutif foudroyant. Sur le plan de l’évolution, nous ne sommes pas déconnectés du reste du vivant. Nous sommes partie du vivant, nous dépendons du vivant et historiquement nous sommes issus du vivant.
L’un des objectifs du MOOC est de mettre en lumière les enjeux de biodiversité et leurs interrelations avec le monde de l’entreprise et de l’économie. Quelles sont les étapes fondamentales pour accélérer la transformation des entreprises sur ce sujet ?
VD : Les entreprises doivent réaliser un travail d’introspection et de diagnostic pour mettre le doigt sur leurs interactions et leurs dépendances en matière de biodiversité. Alors que nous savons que l’ensemble des secteurs économiques ont un impact, certaines entreprises ne se mobilisent pas car elles pensent à tort que leur secteur d’activité n’est pas concerné
Enfin, pouvez-vous nous dire à quoi ressemblent vos futurs désirables ?
PG : Le futur désirable est un futur dans lequel les humains se réconcilient avec le reste du vivant, dans lequel ils le perçoivent et le considèrent. C’est aussi un futur dans lequel s’organise un partage équitable entre les humains. Dans mon monde désirable nous arrêtons de mettre en place des actions manichéennes telles que la suppression ou la multiplication d’espèces et nous conservons une dynamique qui a des effets positifs et durables sur les écosystèmes et sur nous.
VD : Je suis très optimiste de nature. Alors qu’il sera difficile d’inverser la courbe du changement climatique, nous pouvons y parvenir pour la biodiversité. Nous pouvons stopper l’érosion et être revenus à une situation relativement satisfaisante d’ici 2050.
Même si certaines espèces ont disparu et ne reviendront pas, peut-être que certaines se seront développées et que d’autres seront apparues.
J’imagine aussi un futur où l’environnement est beaucoup plus agréable, ou la nature est davantage intégrée à nos villes. J’imagine aussi des campagnes semblables à celles d’il y a 50 ans : des paysages avec des arbres, avec des mares et avec tout le cortège d’espèces que nous avions l’habitude de rencontrer dans ces écosystèmes.