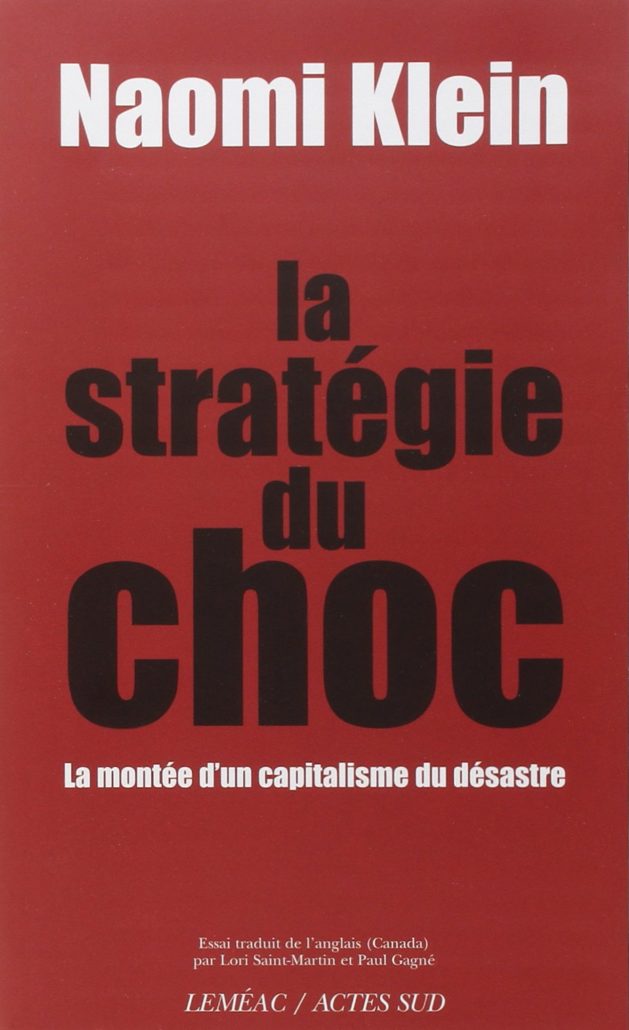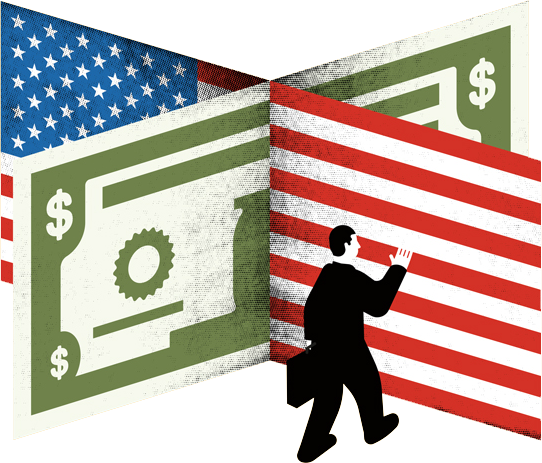Isabelle Lefort est une ancienne journaliste et rédactrice en chef dans la mode. Elle co-fonde en 2019 avec Laure du Pavillon l’association Paris Good Fashion qui vise à faire de Paris la capitale d’une mode plus responsable d’ici 2024.
Peux-tu te présenter ?
J’ai été, en première partie de carrière, journaliste rédactrice en chef de différents magazines d’art de vivre, de mode ou de luxe comme Jalouse, Biba, Elle ou encore La Tribune. En 2009, lors de la crise des subprimes, j’ai ressenti un réel besoin de donner plus de sens à ma carrière. J’ai alors rejoint le secteur du développement durable avec notamment Jacques Attali au sein de Positive Planet où je suis devenue directrice éditoriale de toutes les activités autour du Positive Economy Forum.
En 2018, la ville de Paris m’a sollicitée de par ma double casquette – mode et développement durable – car elle souhaitait accélérer la transition du secteur de la mode. Avec Laure du Pavillon, nous avons cofondé l’association Paris Good Fashion pour répondre à cet objectif.
La naissance de cette association est partie de quel constat de l’industrie de la mode et du textile ?
Lorsque j’ai quitté le secteur de la mode en 2009, le sujet du sens et de la préservation ne portait pas dans ce milieu, il y avait un réel manque de prise de conscience des impacts négatifs de cette industrie. Le scandale du Rana Plaza en 2013 a permis de prendre conscience d’une petite partie de l’impact social désastreux de l’industrie du textile. À tout cela il faut ajouter l’exploitation des femmes et des enfants, les émissions carbone, la consommation astronomique d’eau, la surproduction de plastique… En quelques chiffres, le secteur de la mode serait responsable de la pollution de 25% des eaux mondiales, le coton capterait 93% de l’eau utilisée par l’industrie textile avec 84,5 milliards de mètres cubes d’eau par an, ou encore 87% des matériaux utilisés dans la fabrication des vêtements finissent à la poubelle (source : Climate Chance).
L’industrie du textile et de la mode est donc l’une des industries les plus polluantes et la fast fashion a augmenté ce phénomène. Nous étions dans l’urgence absolue de changer les méthodes de cette industrie.
Constatez-vous une réelle prise de conscience, à la fois de la part des consommateurs mais aussi des marques ?
En 2020, nous avons lancé une consultation citoyenne pour une mode plus responsable : 107 000 personnes ont participé, nous avons recueilli plus de 3 000 propositions et près d’un demi-million de votes. Dans le rapport de la consultation citoyenne, nous rappelons l’étude de l’Institut Français de la mode, commanditée par Première Vision, qui énonce que 64 % des consommateurs ont confirmé leur intention d’acheter des produits de mode éco-responsable au second semestre 2020.
Cela démontre l’intérêt et la prise de conscience du grand public pour le sujet. La volonté de mieux consommer est présente, mais tout le monde n’a pas les moyens c’est pourquoi il est essentiel de développer et démocratiser cette mode durable. On observe également du côté des marques une réelle prise de conscience et des engagements réels. Si certaines sont tentées par le greenwashing, je ne donne pas chère de cette stratégie à haut risque réputationnel, qui n’est pas viable car nous assistons à une transformation profonde des habitudes de consommation et a véritable changement de paradigme. Il y a donc une convergence des prises de conscience, poussée par une législation de plus en plus sévère en France, notamment avec la loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire) qui interdit la destruction des invendus non alimentaires dont le textile.
Pour retrouver toutes les propositions et engagements de la consultation citoyenne de Paris Good Fashion : https://drive.google.com/file/d/1P3zDZpRWuHzov5AAt7e81-tE7uHLMlfR/view
« Nous assistons à une transformation profonde des habitudes de consommation et à une convergence des prises de conscience : il est urgent que l’industrie de la mode change ses méthodes. »
Concrètement, comment Paris Good Fashion agit ?
Paris Good Fashion c’est une association indépendante loi 1901, créée à l’initiative de la ville de Paris. Au départ nous étions 10 membres, aujourd’hui nous allons terminer l’année à 100 membres. Parmi eux, des grands groupes, des marques indépendantes, des distributeurs, des institutions, des écoles, des ONG : de Chanel à la Fondation Ellen Mac Arthur en passant par 1083, Les Galeries Lafayette, Vestiaire Collective…
D’abord nous sommes un écosystème où les acteurs du secteur se parlent, échangent des bonnes pratiques et travaillent ensemble à des solutions concrètes. Ce genre de coalition n’existait pas il y a deux ans, car le secteur est très compétitif et donc chacun restait dans son coin. Ensuite, nous sommes une vitrine pour les acteurs de la mode durable : nous n’avons pas forcement les mêmes méthodologies que nos voisins anglo-saxons de par notre historicité et notre connaissance de la mode et de par le point de vue du législateur qui est très poussé en France.
Pour finir, nous sommes avant tout un laboratoire de solutions concrètes. Nous mettons en place des workshops dans lesquels nous travaillons un problème à la source, dans lesquels nous essayons de trouver des solutions. Par exemple nous avons lancé une étude sur le bien-être animal pour savoir s’il y avait une corrélation entre la bientraitance animale et la qualité des peaux, ce qui est le cas. Cela nous a permis de démontrer aux plus réfractaires qu’il y avait tout intérêt à bien traiter les animaux. Notre objectif est donc de raisonner le marché, de le pousser vers des pratiques plus durables et de veiller à sa progression.
« À la fois un écosystème, une vitrine et un laboratoire de solutions concrètes, Paris Good Fashion a pour mission de raisonner le marché, de la pousser vers des pratiques plus durables et de veiller à sa progression. »
L’association vise à faire de Paris la capitale de la mode durable d’ici 2024. Un objectif réalisable ?
Historiquement, Paris est la capitale de la mode et a donc tout intérêt d’être précurseuse en matière de mode durable. Elle a toutes ses chances d’arriver à cet objectif d’ici 2024 : si vous regardez la cartographie de la mode durable à Paris intra-muros et Paris Ile de France, on recense plus de 400 adresses de marques de jeunes designers, d’ateliers où l’on peut faire réparer, entretenir ses vêtements, de boutiques de seconde main, des think tank… Il existe un réseau incroyable sur le territoire. À Paris, nous avons également des acteurs leaders très fort, comme LVMH, Kering, Chanel ou encore Eram et Etam. Ces groupes sont parmi les plus dynamiques dans la transition vers une mode durable aujourd’hui.
Pendant longtemps nous avons été en retard, par rapport à des capitales comme Copenhague ou Milan qui avait lancé son prix de la mode Green. Mais depuis 2019, il y a un élan et un nombre d’initiatives très important, comme Paris Good Fashion ou encore le Fashion Pact qui sont nées à Paris. Si l’on prend la Fashion Week qui vient de se terminer à Paris, il y a eu de réels efforts de fait : la Fédération de la Haute Couture a mis en place un outil pour mesurer l’ACV (analyse du cycle de vie) des collections et défilés, nous avons également mis en open-source des outils pour éco-concevoir des évènements, réaliser des shootings plus durables… Nous sommes sur le bon chemin et allons tout faire pour réaliser cet objectif.
On parle de plus en plus de sobriété et de décroissance, quel est le rôle de l’industrie de la mode dans cette évolution ?
Je pense qu’il faut cesser la surproduction et la surconsommation. Est-ce que ça fait sens de jeter des millions de produits sur le marché sans réfléchir à la problématique du stock ? Non. Ce modèle-là est obsolète et terminé, il faut donc redéfinir le système. Nous avons besoin de mieux anticiper les besoins des consommateurs, avec des technologies qui permettent de produire à la demande et à la commande. C’est le modèle de la Haute Couture qui va se démocratiser car l’enjeu est d’ajuster la production afin de ne plus stocker et envoyer nos déchets à l’autre bout de la planète, ce qui est une abomination sociale et environnementale.
Quels seraient tes futurs désirables ?
Je souhaiterai que l’on accepte la complexité c’est-à-dire que l’on fasse preuve d’intelligence dans nos échanges, dans nos discussions, qu’on (re)débatte, qu’on analyse et qu’on travaille ensemble. Il faut sortir de la radicalité des échanges, des fakes news (comme selon laquelle l’industrie de la mode serait la deuxième industrie la plus polluante, ce qui est complètement faux), qui ne permettent pas de construire intelligemment et collectivement des solutions.
Photo : © Géraldine Aresteanu